Alison Buckholtz
Paul Collier, économiste du développement, professeur d’économie et de politiques publiques à la Blavatnik School of Government de l’université d’Oxford et ex-directeur du Groupe de recherche sur le développement de la Banque mondiale, est surtout connu pour son travail mené depuis des décennies sur le développement en Afrique et dans les pays fragiles. Cependant, son dernier livre, Greed is Dead: Politics After Individualism, coécrit avec John Kay, examine un sujet bien plus proche de sa culture d’origine : l’impact social corrosif du capitalisme au Royaume-Uni. La thèse défendue dans cet ouvrage, selon laquelle il n’y a pas d’économie prospère sans cohésion sociale ni mutualité des devoirs, s’est nourrie de son travail sur l’Afrique, à l’heure où la pandémie, dit-il, place le continent dans une situation désastreuse. Pour IFC Insights, Paul Collier livre ses réflexions sur les moyens d’en finir avec la cupidité et d’enrayer la menace qui plane sur l’existence même du secteur privé africain. Il explique pourquoi les institutions de développement doivent mener en amont leurs actions dans les pays concernés, de façon à y créer, dans un véritable esprit d’entreprise, les conditions propres à attirer les investissements dans le secteur privé. Par souci de clarté, nous avons abrégé cet entretien et adapté certaines formulations.
Q : Alors que d’habitude, vous vous consacrez surtout aux pays en développement, Greed is Dead traite des maux socio-économiques qui affectent le Royaume-Uni. Pour quelle raison vous êtes-vous penché sur la notion de cupidité ?
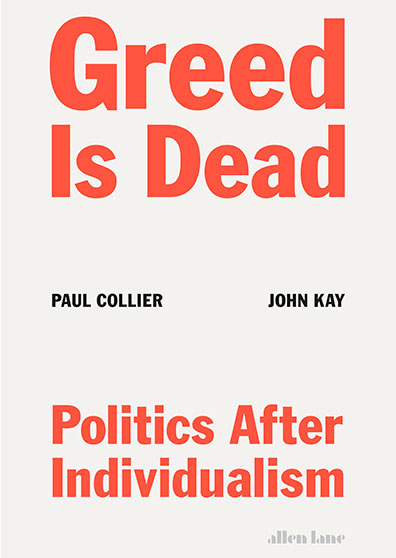 R : En fait, le livre ne dit pas que cupidité n’est pas morte, mais plutôt qu’elle devrait l’être. Dans notre ouvrage, nous tentons de tuer l’appât du gain, intellectuellement parlant, ainsi que les conceptions valorisant la cupidité. Greed est la fusion de deux idées. La première est que nous vivons dans un environnement totalement incertain. L’épidémie de coronavirus, que nul ne sait combattre, nous en fournit un excellent exemple. La seconde idée réside dans l’importance du vivre ensemble, de la cohésion sociale, du sens de la mutualité, d’un maillage de devoirs des uns envers les autres.
R : En fait, le livre ne dit pas que cupidité n’est pas morte, mais plutôt qu’elle devrait l’être. Dans notre ouvrage, nous tentons de tuer l’appât du gain, intellectuellement parlant, ainsi que les conceptions valorisant la cupidité. Greed est la fusion de deux idées. La première est que nous vivons dans un environnement totalement incertain. L’épidémie de coronavirus, que nul ne sait combattre, nous en fournit un excellent exemple. La seconde idée réside dans l’importance du vivre ensemble, de la cohésion sociale, du sens de la mutualité, d’un maillage de devoirs des uns envers les autres.
Q : Vous avez écrit ce livre sur la nécessité d’une cohésion sociale juste avant l’arrivée du coronavirus (COVID-19). La réalité a immédiatement permis de vérifier votre propos. Quel enseignement la pandémie vous a-t-elle apporté sur l’utilité d’un réseau de devoirs mutuels, en temps de crise ?
R : En effet, il était extraordinaire de vivre une situation qui illustrait justement notre propos. Face au coronavirus, personne ne savait que faire. La bonne réaction consistait à nous serrer les coudes, à prendre soin les uns des autres. D’une société à l’autre, on observe des réactions différentes. Dans le meilleur des cas, on s’occupe convenablement d’autrui. Dans le pire des cas, on considère son prochain comme un ennemi.
Q : Pensez-vous à d’autres épidémies anciennes ou récentes qui peuvent guider notre réflexion quant à l’impact de la COVID-19 sur la gouvernance publique et sur l’économie ?
R : Notre livre s’ouvre sur une citation de Périclès, mort de la peste en 430 avant notre ère. Cette épidémie a malheureusement eu pour effet de désintégrer la cohésion sociale sur laquelle était bâtie Athènes. C’est ce qui a causé sa perte face à Sparte.
Aujourd’hui, la COVID donne lieu à des interprétations différentes selon les cultures. En Extrême-Orient, les gens y ont vu une nouvelle forme de SRAS. Comme ils connaissaient les dangers de cette maladie tout en sachant qu’on pouvait la vaincre, ils ont adopté des mesures très efficaces et se sont comportés de manière socialement responsable. En Europe et en Amérique du Nord, l’épisode le plus proche dans les mémoires était la grippe espagnole. Or, croire qu’on a affaire à une « grippette » a des effets désastreux. En Afrique, continent sur lequel je travaille beaucoup, on a observé deux réactions bien plus responsables qu’en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique de l’Ouest, les gens ont pensé à Ebola, à ses ravages mortels et à la manière dont ils ont réussi à l’enrayer. C’est pourquoi ils ont adopté un point de vue responsable sur le coronavirus. En Afrique australe, ils ont pensé au sida. Idem : on savait que cette maladie était mortelle mais qu’on pouvait la contenir, moyennant un comportement social approprié. Sans remonter loin dans l’histoire, il suffit donc d’observer ces exemples se dérouler sous nos yeux dans d’autres parties du monde.
Q : Vous avez récemment signé une tribune dans le Financial Times sur les risques que fait peser la pandémie sur l’avenir économique de l’Afrique. Quelles actions IFC doit-elle entreprendre le plus urgemment sur ce continent ?
R : Cette question est très importante. L’Amérique du Nord et l’Europe ont eu un mérite, c’est de comprendre qu’il fallait protéger le capital organisationnel, c’est-à-dire la substance même de nos entreprises. Celles-ci représentent davantage qu’une somme de matériels : elles se composent de personnes, organisées en vastes équipes pour être productives. Cette organisation est extrêmement précieuse. L’Allemagne a consacré 10 % de son PIB uniquement à sauvegarder ses entreprises, en leur évitant de faire faillite à cause de cette crise. L’Amérique a eu elle aussi le bon sens de dépenser beaucoup dans ce but. L’Afrique possède bien moins d’entreprises, elle en manque même désespérément. Il lui en faudrait beaucoup plus. Mais les États africains n’ont pas assez d’argent pour protéger celles qui existent. Alors que leur rareté les rend très, très précieuses, celles-ci risquent de disparaître. Si rien n’est fait, elles seront toutes en faillite d’ici quelques mois.
Que doit faire IFC ? Elle doit avant tout maintenir à flot les entreprises dont elle s’occupe. Elle devra ensuite inciter les quarante autres institutions de financement du développement à en faire autant, en se coordonnant pour éviter les doublons. Grace à leur travail conjoint, elles parviendront à garder en vie ce capital organisationnel. Voilà la priorité numéro un.
La priorité numéro deux consiste à instaurer d’urgence des mécanismes de soutien aux entreprises qui ne sont pas en contact avec les institutions de financement du développement. Pour cela, on doit décentraliser le capital-risque. Il faudrait mettre en place de petits groupes d’institutions qui travailleraient ensemble, au niveau local et sous la direction d’IFC, à des projets d’investissement en capital-risque dans les entreprises. Voilà, selon moi, les deux véritables priorités d’IFC.
Q : Quel est le calendrier pour cela ?
R : Tout est urgent. Les entreprises d’Afrique, de même que celles d’Amérique du Nord et d’Europe, subissent actuellement une hémorragie financière. Pour commencer, on pourrait collecter des informations régulières et standardisées, qui émaneraient automatiquement et à intervalles hebdomadaires de l’ensemble des institutions de financement du développement, de façon à faire le point sur la situation et à détecter le type d’entreprises le plus en danger. Il faudra en sacrifier certaines. Comme en Amérique du Nord et en Europe, elles feront faillite, et il doit en être ainsi car le monde a changé. Mais partons du principe qu’en Afrique, où les entreprises sont si rares, il faut en préserver la majeure partie.
Q : L’approche « en amont » d’IFC reflète-t-elle le type d’actions que vous évoquiez ? Est-ce le bon modèle pour développer le secteur privé dans les prochaines années ?
R : Tout d’abord, je tiens à souligner que Philippe [Le Houérou] est un leader brillant. Avec lui, on a vraiment eu la bonne personne au bon poste, au bon moment. Et bien entendu, l’approche en amont est celle qui convient. Car comme je disais, l’Afrique ne possède pas assez d’entreprises, elle en manque même cruellement. Les deux tiers de son capital humain sont constitués de travailleurs indépendants ou de très petites entreprises, sans spécialisation ni effet d’échelle. Ce capital humain ne peut être productif que s’il coopère au sein d’une organisation de vaste envergure. C’est cela, une entreprise à proprement parler. On ne peut compter sur des entreprises pour s’installer aveuglément en Afrique. Il faut les stimuler, déclencher l’étincelle qui les incitera à s’y implanter. Voilà en quoi consiste une action en amont.
Q : Dans le domaine du développement, les progrès sont souvent lents. Comment évitez-vous de tomber dans le cynisme ?
R : Je n’ai jamais été cynique. Les cyniques sont des gens qui ont perdu leur âme. Par chance, mes parents, bien que dépourvus d’instruction, m’ont très bien élevé et m’ont donné des repères. Ils ont tous les deux quitté l’école à douze ans mais c’était des gens bien, qui m’ont inculqué le sens du devoir envers les autres. Je me rends compte de la chance fantastique que j’ai eue. Moi, un gamin tout droit sorti de l’école publique à Sheffield, je me suis retrouvé à Oxford. Je suis en quelque sorte la boule de neige qui aurait survécu aux feux de l’enfer.
C’est pourquoi j’ai toujours considéré que la moindre des choses était de mettre mes compétences au service d’un but plus élevé que l’accumulation d’argent à mon seul profit. Je me pose la question suivante : « Que peut faire quelqu’un comme moi pour les autres ? » Attention, je ne me prends pas pour un sauveur. Dans les pays pauvres et fragiles, on trouve certaines des personnes les plus fortes et nobles qui soient, car elles se sont forgées à la dure. Bien qu’entourées d’une pauvreté choquante, elles restent droites. À mes yeux, nul ne mérite davantage le respect. Ce sont elles qui changeront la société dans laquelle elles vivent, pas moi. Mais je fais mon possible pour aider, à ma modeste mesure. C’est pourquoi je ne suis pas cynique.
.
Publié en Septembre 2020
